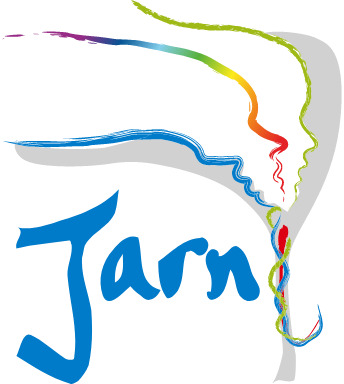Les risques majeurs
Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
Un risque majeur peut entraîner de graves dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement.
Deux critères caractérisent le risque majeur :
- une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être d’autant plus enclins à l’ignorer que les catastrophes sont rares et que la mémoire humaine tend à les oublier ;
- une forte gravité potentielle : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l’environnement.
Un événement potentiellement dangereux (aléa) n’est un risque majeur que s’il s’applique à une zone où des enjeux (humains, économiques, environnementaux ou patrimoniaux) sont présents.
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
Dès lors qu’une commune est exposée à au moins un risque majeur, elle doit en informer ses citoyens en élaborant et mettant à leur disposition un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Cet outil d’information préventive est indispensable pour préparer la population à bien réagir en cas de crise.
Cet outil d’information préventive est un pilier essentiel dans la mise en œuvre effective de la politique de prévention des risques majeurs. Elle permet, au travers de l’amélioration des connaissances, l’adoption par les citoyens de comportements adaptés aux menaces susceptibles de survenir sur des lieux de vie, de travail, de vacances. Il recense les risques majeurs encourus par notre commune à ce jour, tout en informant sur les mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et d’alerte.
Il contribue ainsi à responsabiliser chaque citoyen pour sa propre mise en sécurité, renforçant l’efficacité des mesures mises en œuvre par la commune dans le cadre de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Élaboré à l’initiative du Maire, le PCS vise à organiser ses pouvoirs de police lorsqu’un risque majeur survient.
Il est activé par le Maire (ou son représentant désigné) sur l’ensemble du territoire communal pour tout risque majeur nécessitant un renforcement et une coordination exceptionnelle des services de la ville. L’autorité préfectorale est immédiatement informée de son déclenchement. Le PCS peut également être déclenché à la demande du préfet en complément du plan Orsec (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile).
Cet outil organisationnel décrit un dispositif dont le but n’est pas de tout prévoir mais d’identifier et d’organiser les principales fonctions et missions des acteurs mobilisés à l’occasion d’un événement majeur de sécurité civile.
Pour cela, le PCS
- Détermine les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes (alerter, informer, interdire, sécuriser, évacuer, héberger d’urgence…)
- Fixe l’organisation communale nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité
- Définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population (accueil des personnes sinistrées,…)
- Recense les moyens disponibles sur le territoire communal
APRÈS MINE ET GESTION DES RISQUES MINIERS
Le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) de la Commune de Jarny approuvé le 15 mars 2011 et modifié le 26 mars 2013 est applicable sur le territoire de la commune.
Ce document détermine les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à mettre en œuvre contre les risques miniers, et notamment les affaissements progressifs, les effondrements brutaux et les fontis.
Il se compose des éléments suivants :
- Un rapport de présentation qui indique le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes pris en compte, et leurs conséquences possibles compte tenu de l’état des connaissances,
- Un règlement qui définit les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune des zones ainsi que les mesures de prévention, protection et de sauvegarde,
- Un plan de zonage qui délimite les différentes zones d’aléas.
Le Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI)
Le PPRI de la Commune de Jarny approuvé le 18 septembre 2006 est applicable sur le territoire de la commune.
Ce document réglemente l’urbanisation dans les zones soumises aux risques d’inondation. Il détermine ainsi les mesures d’interdictions et de prévention à mettre en œuvre contre les risques d’inondation de l’Orne, de l’Yron et des ruisseaux des Rouaux et du Fond de la Cuve.
Il se compose des éléments suivants :
- Un rapport de présentation qui indique le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes pris en compte, les aléas et enjeux ainsi que les choix répondant aux objectifs de prévention.
- Un règlement qui définit les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune des zones ainsi que les mesures de prévention, protection et de sauvegarde,
- Un plan de zonage qui délimite les différentes zones d’aléas.
Aléa retrait-gonflement des argiles
Certains minéraux argileux présents dans les sols peuvent varier de volume en fonction de la teneur en eau des terrains. Ils se « rétractent » lors des périodes de sécheresse (phénomène de « retrait ») et gonflent lorsqu’ils sont à nouveau hydratés (phénomène de « gonflement »). Ces mouvements sont lents, mais ils peuvent atteindre une amplitude assez importante pour endommager les bâtiments localisés sur ces terrains.
La variation de leur teneur en eau peut être la conséquence d’une situation météorologique inhabituelle (sécheresse ou fortes pluies), d’une fluctuation du niveau des nappes d’eau souterraines, ou encore de modifications hydrologiques dues à l’intervention humaine. Des arbres situés à proximité de bâtiments peuvent aggraver le retrait des argiles par le prélèvement d’eau de leur système racinaire.
Les dégâts occasionnés par ce type de mouvement de terrain peuvent être indemnisés au titre des catastrophes naturelles si l’état de catastrophe naturelle est reconnu par arrêté interministériel.
Catastrophe naturelle
Une catastrophe naturelle est caractérisée par l’intensité anormale d’un agent naturel (inondation, coulée de boue, tremblement de terre, avalanche, sécheresse…). Elle est, toutefois, limitée aux dommages matériels directs (atteinte à la structure ou à la substance même de la chose assurée).
La démarches de reconnaissance de l’état de reconnaissance de catastrophe naturelle sont effectuées par Monsieur le Maire auprès de Madame la Préfète du Département de Meurthe-et-Moselle, après que un ou plusieurs Jarnysiens se soient fait connaître en Mairie à la Direction de l’Aménagement du Territoire.
Lorsque l’intensité anormale d’un agent naturel a été identifiée et a provoqué des dommages, un arrêté interministériel constate l’état de catastrophe naturelle et permet alors l’indemnisation des dommages directement causés aux biens assurés.
Pour être indemnisé pour les dommages imputables à une catastrophe naturelle, il faut que :
- les biens endommagés soient couverts par un contrat d’assurances « dommages aux biens » ou « pertes d’exploitation »,
- l’état de catastrophe naturelle ait été reconnu par arrêté interministériel pour le phénomène ayant provoqué les dommages,
- le sinistré déclare les dommages à son assureur dans le délai requis.
La garantie instituée par la loi couvre notamment les dommages résultant des risques suivants :
- inondations (par débordement de cours d’eau, par remontée de nappe phréatique, par ruissellement, par crues torrentielles),
- coulées de boue,
- mouvements de terrain (affaissements et effondrements, éboulements et chutes de blocs de pierres ou de rochers, glissements et coulées boueuses associées),
- mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols,
- séismes